
L’article La Vie Sous le Joug des Talibans est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>
L’article La Vie Sous le Joug des Talibans est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>
L’article Le Récit de la Découverte des Crimes de Guerre à Boutcha est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article <strong>« Pour aider concrètement la jeunesse iranienne »</strong> est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>Comment analysez-vous le mouvement de révolte qui agite l’Iran aujourd’hui ?
Je pense que le régime théocratique ne tombera pas de sitôt. Le peuple iranien est entré dans une confrontation qui durera des mois voire des années comme je l’avais prédit dans mes livres. La femme iranienne, 25 ans d’inquisition (1994), retrace la révolte des femmes dès la « révolution islamique » de 1979, Ali Khamenei ou les larmes de Dieu (2011) prévoit la révolte actuelle de la jeunesse d’Iran, Le colonel ou l’appât 445 (2014) met en lumière les pratiques en cours dans les prisons du régime des mollahs…
Quel est l’objectif de l’association Mo-Ha ?
Aider les étudiants, et si possible les sortir de prison en payant leurs frais d’avocat et leurs cautions pour une libération conditionnelle. La monnaie iranienne ne vaut plus rien, les inégalités explosent, l’inflation fait rage. Hypothéquer des biens, mettre en gage des années de salaire reste la seule solution pour les familles modestes qui se ruinent à essayer de sortir leurs enfants de prison. (Le montant des cautions répertoriées à ce jour pour les étudiants varient de 2.000 à 70.000€). Une fois libérés, ceux-ci, meurtris par les traitements qu’ils ont reçus, exclus de l’université et privés de travail, ont encore besoin d’être soutenus. La résistance est avant tout une question de survie économique…
L’association Mo-Ha, indépendante et composée de bénévoles, voudrait lancer une collecte au profit des étudiants victimes de la répression. Nous comptons déjà de précieux soutiens, dont Annie Ernaux et Cédric Villani pour ne citer que les derniers en date. Depuis ses débuts, Mo-Ha s’est toujours voulu concrète, d’abord en aidant les réfugiés iraniens à s’intégrer en France puis en mettant en place des ponts culturels et scientifiques entre l’Iran et La France. Notre connaissance des réalités du pays nous permet aujourd’hui d’envisager des actions de terrain pour soulager la souffrance des familles de cette héroïque jeunesse qui se bat pour ses droits élémentaires. Toutes les informations seront sur le site web de l’association www.mo-ha.com.
L’article <strong>« Pour aider concrètement la jeunesse iranienne »</strong> est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Iran : la république des tortionnaires est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>« C’est le sort des étudiants »
Le « guide suprême », Ali Khamenei, a demandé aux juges d’accélérer le rythme des condamnations : « XXX ». C’est la seule réponse proposée par la république islamique aux contestations qui soulèvent le pays depuis le 22 septembre, date du tabassage à mort de Masha Amini par les garde-chiourmes du régime : elle avait été arrêtée pour « port de vêtements non appropriés » ; son voile n’était pas suffisamment relevé… Une répression impitoyable qui s’abat en particulier sur les étudiants, ar plus de trois mois, fer de lance de la révolte.
Après sa sortie de prison, Abtine Behrang, un doctorant en sciences politiques a osé raconter son calvaire. Arrêté le 25 septembre 2022, il est interrogé pendant plus de douze heures, battu, injurié, et finalement jeté dans une geôle d’Evin : « Dans le couloir étroit du secteur 241, le nombre des prisonniers agglutinés faisait que, collés les uns aux autres, nous dormions debout. Beaucoup s’évanouissaient à cause du manque d’air. Une seule toilette et un seul robinet d’eau potable pour la centaine de personnes que nous étions dans ce secteur. » Après treize jours à Evin, Abtine est transféré dans la grande prison de Téhéran. Encore quelques jours se passent et il est conduit devant le tribunal révolutionnaire, sans jamais avoir eu le droit de prévenir ni sa famille ni un avocat. « Le 24 décembre 2022, le tribunal a informé ma famille que j’avais écopé de quatre ans de prison ferme. Quatre ans d’enfermement, c’est le sort d’un étudiant contestataire ! » déplore le jeune homme dans le communiqué de son collectif d’étudiants. Abtine fera finalement partie des heureux libérés sous caution, mais il confie son inquiétude pour ses camarades. Pour Milad Abdi, par exemple, dont l’oreille interne est déchirée (sans doute à cause des gifles et autres sévices infligés par les gardiens) et qui ne reçoit pas de soin. Ou pour Zohreh Jam, une étudiante en art graphique et secrétaire du collectif étudiant de Tabyat Modaress, qui a été le 24 décembre : elle aussi détenue à Evine, elle souffre d’une grave maladie aux yeux grave qui exige une opération.
« Les Étoiles filantes de l’Iran »
Quand Leyla n’est pas rentrée de l’université à l’heure habituelle, Mahine a tout suite compris que sa fille âgée de 21 ans venait d’être arrêtée. Pendant trois semaines, cette mère qui élève seule ses trois enfants dans la ville de Chiraz, l’a cherché en vain : « Imaginez mes jours et mes nuits, soupire Mahine. Mes cauchemars à l’idée que Leyla soit battue, maltraitée, voire violée. Toutes les mères pensent aujourd’hui à Kahrizak [ndlr le centre de détention où lors des émeutes de 2009 des cas de viols ont été dénoncés]. » Vingt-trois jours après sa disparition, Mahine apprend enfin que sa fille est incarcérée dans la prison centrale de la ville.
Leyla a été accusée de « propagande contre le régime » pour un dessin intitulé « Les étoiles filantes de l’Iran », sur lequel apparaissent les visages des gamins et des gamines tués depuis septembre. Elle a aussi été accusée « d’injures aux autorités » pour avoir dit à un responsable de sa faculté « qu’au lieu de défendre les étudiants et l’espace universitaire, il se comportait comme le bras des services de renseignements ». Et Leyla a été condamnée à 94 coups de fouet pour « comportement illégal et anti islamique portant préjudice à la paix universitaire »…
Tous les professeurs des universités ne jouent toutefois pas les assistants des mollahs dans la répression qui frappe les étudiants. Dans une lettre ouverte, le Dr Mojtaba Mojtahédi, enseignant à l’université de Téhéran, dénonce au contraire les pressions exercées sur ceux qui ne veulent pas dénoncer les étudiants contestataires. « Zahra Rezaï Ghahroodi, la vice-présidente du collège des sciences, a exigé que nous empêchions les étudiants de manifester et que nous fassions l’appel tous les jours, à chaque cours, pour condamner les absents à des sanctions disciplinaires lourdes… Tous savent que je ne fais pas d’appel comme au jardin d’enfants. J’ai donc été convoqué par Vahid Niknam, à la direction de l’Université, qui m’a menacé de limogeage et d’interdiction de sortie du pays, sachant que j’avais fait une demande pour une année de recherche en Belgique… Demande qui m’a été depuis refusée. »
Sous le choc, après avoir appris la condamnation de sa fille, Mahine écrit une lettre au procureur pour que Leyla, qui souffre d’asthme aigu, soit libérée sous caution. Le procureur, qui sait pourtant que Mahine est une mère célibataire, une simple employée de laboratoire, fixe le montant de la caution à un milliard et demi de toumans (environ 35.000€). Exceptés quelques tapis, la laborantine ne possède rien, mais pour sa fille, elle rassemble toute sa famille. Le mari d’une de ses sœurs met sa maison en hypothèque, son frère sa voiture, deux cousins leurs magasins. « A la sortie du centre du détention, Leyla a éclaté en sanglots et m’a dit que je n’aurais jamais dû entraîner les autres dans notre malheur… Traumatisée, elle n’a pas encore dit un mot sur ce qu’elle a subi durant son enfermement. Mais la psychologue qu’elle voit m’a donné quelques indices en me disant que les menaces entendues (le viol que pourrait subir son frère cadet, l’enlèvement de sa mère…) lui ont laissé de graves séquelles. »
De nombreux parents sont aujourd’hui dans la même situation que Mahine. Ainsi la famille de Samaneh Asqari, étudiante à l’Université Kharazmi de Téhéran. Elle a six chefs d’accusation contre elle. Le premier, « atteinte à l’ordre public », dépend de la section 7 de la prison d’Evin qui ressort du tribunal de droit commun. Mais les cinq autres chefs d’accusation dépendent de la section 15 du tribunal révolutionnaire. Les parents devront donc payer deux cautions avant d’obtenir la libération de la jeune femme. Les parents se sentent tous démunis face à la complexité du système juridique mis en place par la république islamique.
Mollahs contre mollahs
Face à la révolte, les religieux ultra conservateurs exigent plus de radicalité : ils demandent que l’on augmente les pendaisons, et que l’on revienne aux châtiments corporels, au fouet, aux mains coupées, aux pieds sectionnés, selon les préconisations de la charia. Le mollah Mohseni Ejéi, chef du système judicaire iranien, se réfère au Coran pour justifier la peine capitale contre « les corrupteurs sur terre et les ennemis de Dieu ». Quant au mollah Ahmad Khatami, membre du conseil des experts, il exige que l’acte de « faire tomber par terre les turbans des mollahs », comme on voit de jeunes facétieux s’y amuser dans les rues, soit considéré comme un délit « d’inimité envers Dieu », ce qui les ferait encourir une condamnation à mort par pendaison… Les avis de ces hommes présentés comme éclairés se succèdent dans tous les domaines. Ainsi selon le mollah Ali Khan Mohammadi, porte-parole du bureau de l’incitation au bien et à la prévention du mal, « le problème n’est pas le voile, mais ce que sa disparition signifie : l’homosexualité légalisée, la nudité des femmes, et les actes sexuels en public ».
En même temps, des voix divergentes commencent à se faire davantage entendre. Des mollahs modérés ou contestataires, comme le petit-fils de Khomeiny ou les héritiers spirituels de Montazeri (dauphin de Khomeiny, écarté du pouvoir en 1988, et devenu le religieux le plus contestataire), expliquent être très inquiets du caractère sanglant de la répression. Dans l’entourage même du « guide suprême », on se plaint ouvertement de la haine que le clergé chiite inspire aujourd’hui en Iran : « Il est tout de même affligeant de constater que c’est le mollah Abdol Majid soit devenu le religieux le plus populaire en Iran ! [ndlr Abdol Majid est un religieux sunnite, chef des croyants du Baloutchistan, région d’où est partie la révolte]. » Enfin les jeunes mollahs de Qom, dont plusieurs sont des lettrés et des chercheurs qui communiquent avec les centres religieux du monde entier, se plaignent de la haine dont ils font l’objet sur les réseaux sociaux : « Les mollahs au pouvoir ont de l’argent, ils sont protégés et circulent dans des voitures blindées… Nous, nous sommes à la merci de la vindicte populaire ! »
Képi contre képi
Le caractère sanglant de la répression commence aussi à susciter des critiques au sein des forces armées. Certains membres des Gardiens de la révolution seraient convaincus qu’il ne sert à rien de tirer sur les manifestants. Ainsi, Qassem Fathollahi vient d’être exécuté parce qu’il aurait refusé de tirer sur les manifestants et pris contact avec des bassidjis qui partagent sa position. Des gradés des forces armées reconnaissent également que les désertions sont de plus en plus importantes. Un des déserteurs, qui a quitté le pays, s’adresse directement dans une vidéo à Khamenei : « Nous étions tes fidèles, et c’est la misère, la prostitution de nos filles, la corruption de tes proches qui vendent le pays, qui nous ont détournés de toi et de ton régime… » Signe de ces guerres intestines, Khamenei vient de limoger le commandant en chef des forces de sécurité Hossein Achtari…
Pourtant, malgré ces contestations internes, le régime de la République islamique ne semble pas encore prêt de vaciller. Ainsi, sur la question du port du hijab, uniforme obligatoire de la révolution et tissu qui a mis le feu aux poudres de la contestation, le régime n’évolue pas. Bien sûr, il y a les déclarations alambiquées du « guide suprême », qui affirme à la fois que le port du hijab est et restera obligatoire, tout en précisant que les « mal voilées » ne doivent pas être considérée comme des impies. Il prétend aussi que les Iraniennes ont donné une gifle « aux ennemis de l’Iran » puisqu’elles ont gardé leur voile même si elles le portent mal. Il n’en reste pas moins qu’une nouvelle série de lois sanctionnant l’absence de port du hijab a été proposé au parlement avec des peines qui vont d’amendes au licenciement pur et simple. Et que tous les discours des mollahs lors de la dernière prière du vendredi ont été consacrés au hijab et à sa « sacralité ».
L’article Iran : la république des tortionnaires est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Raïssi, la face sanglante de la république des Mollah est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>Avec sa barbe, ses lunettes et son turban noir, sa démarche incertaine et son verbe hésitant qui le fait trébucher sur les mots comme sur des trottoirs trop hauts, son manque absolu de charisme, Raïssi vient d’être élu à la présidence de la république d’Iran avec 62% des voix. Ce disciple du guide suprême et son factotum de basses œuvres restera-t-il comme l’un des grands criminels de l’histoire ? Cette accusation ce n’est pas une ONG américaine qui la formule mais l’ayatollah Ali Montazeri, celui la même qui avait été désigné comme le dauphin de l’imam Khomeiny, qui la porte. Voici dans quelles circonstances : Le 15 aout 1988, trois semaines après le début d’une opération menée par la jeune république islamique qui conduira à la mort de plus de 30000 prisonniers politiques, l’ayatollah Montazeri demande à voir les quatre membres de la « commission de la mort » qui, c’est une fatwa de Khomeiny qui l’a ordonné, décide du sort des opposants à la révolution. Raïssi, alors âgé de 27 ans, en est son vice procureur. Le religieux pacifique est horrifié parce qu’on lui rapporte. Les révolutions naissent souvent dans le sang, et se poursuivent en épurations, mais lui ne cautionnera jamais cette campagne systématique d’exécutions de gens non jugés ou à la veille d’être relâchés parce qu’ils ont purgé leur peine : « Le crime le plus terrible perpétré en république islamique depuis la révolution et pour lequel l’histoire va nous condamner a été perpétré par vous. Et vous serez considéré au nombre des criminels de l’histoire » Incroyable témoignage ! On entend la voix claire de Montazeri, qui détache les syllabes de sa consternation, au cours d’un enregistrement dévoilé par son fils en 2016 pour la commémoration des 28 ans de « l’été sanglant ». « On déclenche une boucherie là bas (dans les prisons), on les retire des cellules et pan, pan ! Mais ou au monde se comporte t’on comme cela ? » s’étrangle ce fondateur de la république islamique « Elle avait 15ans. Le juge a dit que son frère avait été exécuté et qu’il fallait l’exécuter aussi. A Ispahan on a exécuté une femme enceinte !! » continue-t-il écœuré.
Lorsque l’ayatollah demande à Raïssi et ses acolytes de la « commission de la mort » de suspendre les exécutions pendant le mois sacré de Moharam, voici ce qu’on lui répond : « Pour Moharam, nous avons déjà un certain nombre de prisonniers que nous avons extrait de leurs cellules pour les interroger…Si on ne se prononce pas et qu’ils retournent dans leurs sections cela va créer des problèmes. Si vous le permettez, il y en a environ 200 personnes et quelques, on va les (exécuter)… » négocient conciliant Raïssi et ses collègues « Non je ne le permet pas ! » s’indigne Montazeri « le peuple va juger Khomeiny comme une figure sanguinaire et cruelle ! » Pour cette prise de position humaniste, l’ayatollah sera non seulement écarté de la succession de Khomeiny, mais restera toute sa vie en résidence surveillée jusqu’à sa mort en 2009.
« Raïssi c’est vraiment Eichmann vu par Hanna Arendt. Un bel exemple de la banalité du mal » analyse un politicien iranien , « Un fonctionnaire qui balbutie le credo du gouvernement du docte, un rouage utile de la république des mollah, un exécutant zélé des fatwas et basses œuvres de Khamenei, un « banal » antihéros aux actes monstrueux qu’il exécute parce qu’on lui en a donné l’ordre » Et quels actes, et quels ordres ! Un rapport d’Amnesty International détaille les massacres : les enfants assassinés parce qu’ils accompagnaient les parent à des manifestations, les fausses sépultures, les parents rafflés parce qu’ils se recueillent sur la tombe d’un proche…
Alors Raïssi est il seulement ce fonctionnaire falot authentiquement pénétré de la Weltanschauung (« vision du monde ») khomeyniste ? Il lui aura fallu pourtant plus que de la persévérance mais aussi une bonne dose d’ambition, pour gravir un à un tous les échelons du système répressif du régime des mollahs.
Son ambition pointe déjà dans le nom qu’il s’est choisi, car Raïssi n’est pas le nom de son père, petit mollah modeste de la région de Mashad. Lui se fait vite appeler Raïss-ô-ssadat : le président des sayyed, (les descendants du prophète). Tout un programme pour cet hodjatoleslam( sous-ayatollah) qui n’est pas allé plus loin que le collège. Dans la biographie qu’il a posté sur les réseaux sociaux, il se déclare donc descendant du prophète, par son père et par sa mère et par Zaïd, partisan de l’insurrection armée contres les Califes, ce qui l’autorise à arborer son turban noir et établit son culte de l’Islam armé.
Il a dix huit ans lorsque la révolution éclate en Iran et il fait tout de suite partie des zélateurs de l’actuel Guide Suprême, Ali Khamenei, qui habite à quelques centaines de mètres de chez lui à Mashad. Son premier fait d’arme révolutionnaire est le pillage très contesté du Palais des perles de la sœur du shah : 11 camions en sortent chargés de tout un mobilier historique qu’on ne reverra jamais. A 20 ans, il est déjà Procureur général de la ville de Karaj, à côté de Téhéran, chargé de poursuivre les ennemis du nouveau régime, attaqué au même moment par l’Irak de Saddam Hussein. Au lendemain de la révolution, Mr. Raisi épouse Jamileh Alamolhoda, une femme au visage sévère, toujours drapée dans un long tchador noir. Jamileh, professeur d’université et mère deux filles est la fille d’un religieux conservateur qui dirige la prière du vendredi à Mashad et qui avait été chargé par Khamenei de reprendre en main le Khorasan, une des régions les plus grandes et plus riches d’Iran, en y interdisant les concerts et la bicyclette pour les femmes. Il est ensuite envoyé par Khamenei à Hamedan, la ville natale de Bani Sadr, premier président de la République islamique d’Iran destitué en juin 1981, pour superviser la répression de ses partisans. Puis rappelé à Téhéran pour seconder le procureur de la toujours tristement célèbre prison d’Evin. Celle ou est détenue aujourd’hui l’avocate Nasrine Soutoudeh et ou Raïssi, distribue depuis qu’il préside aux destinées de la justice iranienne des peines de coup de fouets et de dizaines d’années de prison aux détenus politiques avec la prodigalité d’un juge du Texas.. Puis pendant que la guerre Iran-Irak fait des millions de morts, Raïssi continue de grimper les échelons du système judiciaire. De 18 à 27 ans, Raïssi, organise la répression, élimine physiquement la chienlit des contestataires qui affaiblissent la révolution : « c’est sa constance dans l’appareil répressif qui explique son incroyable ascension » confirme un diplomate. Jusqu’à l’apogée des massacres de 1988, dont le président fraichement nommé continue à soutenir la nécessité aujourd’hui.
Il sera ensuite procureur du puissant tribunal spécial pour le clergé, qui s’occupe des mollahs qui sont sortis du droit chemin comme Montazeri et ses disciples par exemple. A ce poste pendant près de 18 ans, il fait régner l’ordre parmi les religieux et étudie la mécanique de l’organisation de la terreur. En 2009, après la répression féroce frappant les manifestants contre la réélection controversée de l’ancien président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, M. Raïssi, alors premier adjoint du chef de la justice de l’époque, est chargé de traiter les plaintes sur les mauvais traitements dans les prisons (viols, tortures et décès). Son rapport final est sans surprises : les plaintes sont toutes diffamatoires et les personnes qui les ont formulées doivent être poursuivies par la justice. Touche finale pour compléter le trousseau du meilleur candidat à la présidence de la république islamique, le guide le nomme en 2016 à la tête du mausolée de l’imam Reza, le ¬huitième imam chiite à Mashad, et de la très riche fondation Astan Qods Razavi qui gère ses biens. Pendant trois ans, les aides dispensées aux plus pauvres par la fondation sont couvertes par les médias et les réseaux sociaux proches de Raïssi. Enfin nommé à la tête du pouvoir judiciaire en 2019 par le Guide, Ebrahim Raïssi modernise le système judiciaire, et vide les prisons surpeuplées aux deux tiers en allégeant les peines pour les chèques sans provisions et les dots en pièces d’or non payées (ces deux sujets concernent des millions de personnes en Iran). A la tête du système judiciaire, véritable Etat dans l’Etat qui constitue le quatrième holding financier d’Iran, Raïssi consolide la caisse qui servira à sa campagne en y déposant directement l’argent des amendes et des expropriations…
Fort de tous ces pouvoirs (financier, judiciaire, religieux), le président pourrait à terme prétendre à succéder au Guide suprême, âgé de 82 ans. « Khamenei a quatre fils, chacun avec des tribus qui se disputent. Aucun ne lui ressemble autant que Raïssi » explique l’analyste politique iranien Ahmad Salamatian. « Il a été le disciple d’Ali Khamenei, tout comme ce dernier a été l’étudiant de Ruhollah Khomeyni [le fondateur de la République islamique]. De plus, Ali Khamenei a été président [de 1981 à 1989] avant de devenir Guide. Ce serait donc une succession dans les règles du gouvernement du docte, d’autant que Raïssi préside la commission pour la succession du guide au sein de l’assemblée des experts »
Les dissidents politiques redoutent la présidence de Raïssi. C’est lorsqu’il était à la tête de l’autorité judiciaire (2019-2021) que l’ONG caritative Imam Ali, active dans la lutte contre la pauvreté, a été interdite. Tandis que, en 2020, le dissident Rouhollah Zam, exilé en France d’où il animait une chaîne d’information sur la messagerie Telegram, a, lui, été kidnappé à Nadjaf et exécuté. Et pourtant cette militante qui lutte pour le droit de ne pas porter le voile ne s’attend pas obligatoirement à des jours plus sombres pour la société civile iranienne sous la présidence Raïssi : « si la répression des mœurs ne rend plus service à la république islamique, alors il assouplira les règles » Signe de cette éventualité, Raïssi a annoncé que le rappeur dissident Amir Tataloo exilé en Turquie pourrait rentrer en Iran. En échange celui-ci a fait campagne pour l’ultra conservateur…
Autre nouvelle paradoxale : alors qu’il y a quatre ans, à l’époque candidat à la présidentielle face au président Hassan Rohani, Ebrahim Raïssi n’avait manqué aucune occasion de s’en prendre à l’accord conclu en 2015 avec la communauté internationale, cette fois, il a adopté un ton beaucoup plus nuancé. « Nous considérons l’accord comme un contrat que le Guide suprême a validé et nous nous engageons à le respecter », a-t-il soutenu lors d’un débat télévisé avec ses rivaux.
D’ailleurs, les partisans d’une realpolitik voient dans l’élection d’un conservateur à la présidence de la République, la fin de l’inertie et des complications que génèrent un pouvoir bicéphale. « Certes, la relation avec l’Occident sera plus rude, anticipe un diplomate. Mais on aura, au moins, un gouvernement qui fera ce qu’il dit. Alors que sous Hassan Rohani, les mots du ministre des Affaires étrangères, Javad Zarif, n’engageaient que lui, nous entrainant dans des exégèses et des allers retours inutiles » Dans un entretien avec l’économiste Sayeed Leylaz, qui avait fuité dans la presse américaine, le ministre des affaires étrangères iranien se plaignait de l’interférence constante des gardiens de la révolution dans la conduite de la politique étrangère, et exposait son manque complet de pouvoir. « Les choses devraient être plus claires désormais alors que l’Iran a renoncé à apparaître comme un régime démocratique qu’il n’est pas » continue le diplomate. Si les Etats-Unis, la communauté internationale et l’Iran arrivaient à reprendre la voie des négociations, ce serait le régime et non pas un gouvernement réformateur qui serait crédité de l’amélioration de la situation économique. Reste que, comme le déplorait le secrétaire d’État américain Antony Blinken, le « délai de rupture » dont l’Iran a besoin pour fabriquer une bombe atomique pourrait être réduit à quelques semaines seulement, si Téhéran continue de violer l’accord de 2015 limitant son programme nucléaire. Soutenu par la Russie, puissance influente dans la région, l’Iran a progressé sur tous les fronts. Et si il fallait désormais traiter avec Raïssi comme avec Kim Jong-un ?
L’article Raïssi, la face sanglante de la république des Mollah est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Ukraine : <strong>La guerre gelée du Donbass</strong> est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>Dima s’est éloigné dans les bourrasques de neige avec ses hommes, un conclave bref comme ces coups de feu qu’on entend résonner dans les steppes blanches. Quand il est revenu les yeux rougis d’alcool et de chagrin, il a une fois encore levé son verre à notre santé : « A Poutine, le fils de pute grâce à qui j’ai rencontré de vrais amis de l’Ukraine ! » Et tout le monde a gobé le liquide qui noie le souvenir des morts. 13.000 morts qui ponctuent cette guerre de huit ans. 13.000 jusqu’à celui-ci, le premier depuis le nouveau cessez-le-feu déclaré le mois dernier, mais aussitôt rompu, comme tous les autres. Dima m’avait prévenu pourtant : à 23 heures, il sera minuit pour les séparatistes prorusses puisqu’ils ont réglé leur montre à l’heure de Moscou, et le camp d’en face sera sans doute tenté de célébrer le passage à la nouvelle année autrement qu’avec des feux d’artifice. Et puis tout le monde a continué à boire la cerise assassine, tandis que les morceaux de chachlik (des brochettes d’agneau) sont restés dans le seau et que la selyodka pod shuboy (de la pâte de hareng et de pommes de terre recouverte de grains de grenade) s’est figée dans les barquettes en plastique. La sono jouait dans le vide le dernier rap ukrainien qui chante les vaccins inefficaces contre la covid. Devant les baraquements, des soldats coiffés de chapeaux rouges et blancs, tristes pères noël, titubaient sous les flocons gelés.
A quelques pas d’eux, une jeune femme essuie ses yeux. Son militaire lui a posé un lapin, après lui avoir envoyé des poèmes d’amour toute la journée. Ou plutôt il tarde à rejoindre la petite fête à laquelle elle a pu, elle aussi, exceptionnellement participer. Elle vient de parler à son père qui habite à Donetsk, si inutilement proche puisque de l’autre côté de la ligne de front. Elle ne l’a plus revu depuis deux ans. Chaque semaine, le vieil homme trouve un prétexte pour l’appeler, lui poser une question absurde, lui faire traduire les paroles d’une chanson américaine qu’il a entendue. Elle n’a jamais le temps de lui répondre et elle s’en veut : « Pourquoi les parents appellent-t-ils toujours quand on est occupé ? » Et elle pleure sur son sort et sur celui de ce jeune soldat mort dans la nuit, sur tous ces destins brisés le long de cette ligne de guerre qui n’en finira jamais.
Poursuivre l’étoile de l’Otan
Dima, qui commande 300 hommes à 28 ans, nous avait fait encore une autre confidence plus tôt dans la soirée : il voudrait prendre sa retraite avant que la guerre finisse. Personne, selon lui, n’a intérêt ni à l’escalade ni à en finir. Et pourtant… si l’Occident voulait, « ils en auraient vite fini avec les Russes ». Né à Donetsk, Dima a des amis d’enfance chez les séparatistes. Parfois il prend de leurs nouvelles par connaissance interposée, mais cette nuit il les appelle les « orques, vous savez les brutes dans ‘‘Le Seigneur des anneaux’’ ». Les yeux brillants, il raconte qu’il a assisté au tir du drone turc Bayraktar TB2 qui, le 26 octobre dernier, a détruit une batterie d’obusiers russes près du village d’Haranitne. Ce sont ces mêmes drones turcs qui ont facilité la victoire de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie dans le Karabagh.« Le tir a été d’une précision chirurgicale et les drones volaient tellement haut dans le ciel qu’on ne pouvait ni les voir ni les entendre. » Dima se félicite de la coopération avec Erdogan, un allié de l’Ukraine parce qu’il a compris, dit-il, le pouvoir de nuisance de Poutine. Il s’empresse d’ajouter : « On ne choisit pas ses alliés ; je n’aurais jamais imaginé, par exemple, que les avions de la Luftwaffe allemande transporteraient nos blessés pendant le conflit de 2014… » Pour contourner l’une des interdictions de Minsk II, celle d’utiliser des armes importées, l’Ukraine devrait d’ailleurs prochainement fabriquer sur son propre territoire des drones mis au point par le fabricant turc : des Bayraktar Akinci que l’on présente comme plus sophistiqués encore que les Bayraktar TB2.
Avdiivka, où a été tué le soldat ukrainien, est une ville dortoir dont les barres d’immeubles gris se dressent dans la suie des cheminées de l’usine de coke voisine. Ce gigantesque complexe industriel est la propriété de l’un des oligarques les plus puissants d’Ukraine, Rinat Akhmetov. Fils d’un pauvre mineur, le milliardaire pèse aujourd’hui 9,3 milliards d’euros, achète son charbon en territoire séparatiste, le transforme en territoire loyaliste et, insoucieux des haines et des nationalismes, poursuit sa profitable entreprise de part et d’autre du front. Ici, l’argent à l’odeur du charbon. Ici, presque tout le monde a travaillé, travaille ou travaillera un jour à l’usine d’Akhmetov. Conquise par les rebelles en avril 2014, la ville est retournée sous contrôle gouvernemental en juillet de la même année. Et entre prorusses et pro-ukrainiens, son cœur balance comme la fumée qui salit la neige et le ciel du Donbass.
Au deuxième étage d’un building qui en compte cinq, l’appartement d’Olga a été bombardé en 2014, 2015, 2017. Les fenêtres sont toujours calfeutrées par des panneaux de bois aggloméré. Ses parents et son mari, qui travaillaient tous à l’usine, sont morts dans cet appartement ; des attaques cardiaques sans doute conséquentes du stress. Pendant qu’elle prépare la nourriture de Noël, une dinde et des tiramisus, avec sa fille professeur à l’université d’Odessa, elle explique qu’elle ne se remet toujours pas d’avoir vu sa maison « blessée ». « Je pensais naïvement que rien ne pourrait m’arriver de mal dans cet appartement. » Le petit drapeau des Etats-Unis qui orne la table du salon affiche clairement ses préférences, ce qui ne l’empêche pas de reconnaître que les œuvres de charité d’Akhmetov sont bien plus efficaces que le gouvernement actuel : « L’immeuble d’à côté a été réparé par l’usine. Nous, malheureusement, nous dépendons de la municipalité, alors avec la corruption rien ne se passe… » Et pourtant, Olga aime bien l’actuel président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky : « Ils disent que c’est un amateur, mais il est proche du peuple. Quand je l’écoute, j’ai bon espoir de pouvoir revoir Donetsk un jour. Car Donetsk, c’était notre grande ville, on allait y voir des concerts, on aurait presque pu y aller à pied », soupire-t-elle.
Zelensky, humoriste et acteur, a été élu président en mai 2019. Ses détracteurs disent que sa principale compétence pour le poste est le fait d’avoir incarné dans une série très populaire, intitulée « Serviteur du peuple », le rôle d’un professeur d’histoire qui devient un président anti-élite. Il restera en tout cas aussi dans l’histoire pour avoir obtempéré à la demande de Trump qui, quelques jours après avoir accordé de l’aide militaire à l’Ukraine, lui a demandé de relancer une enquête sur Hunter Biden, le fils de son concurrent démocrate Joe Biden.
Retour en Union soviétique
Dans les escaliers, un homme qui s’appuie sur une canne gravit péniblement les marches jusqu’au 5e étage. Cela fait 35 ans que son corps le lâche peu à peu. Depuis les jours qui ont suivi le 26 avril 1986, lorsque, soldat de réserve de l’Union soviétique, il s’est porté volontaire pour aller « nettoyer » l’usine de Tchernobyl. Car Dimitry Tselukh est un « liquidateur » de la catastrophe nucléaire. Il nous invite dans un appartement impeccable où domine la couleur marron, comme s’il vivait dans la photographie figée d’un appartement à la mode de cette époque. Il y fait au mieux 10 degrés : le toit de l’immeuble, détruit au cours de la guerre de 2015, n’a toujours pas été réparé et l’eau suinte le long des murs. Lui aussi peste comme sa voisine Olga, mais ne vise pas les même responsables…
Lorsque je lui demande s’il a reçu une médaille pour son dévouement à Tchernobyl, il éclate de rire : « Parce que, dans votre pays, les décorations sont vraiment décernées à ceux qui les méritent ? » Comme seul remerciement de son dévouement, Dimitry, qui a passé 25 jours à proximité du réacteur et a vu bon nombre de ses camarades mourir, n’a été gratifié que de visites médicales gratuites, une tous les six mois, pour constater les dégâts produits par les becquerels de matière radioactive absorbés par son corps. Pourtant, il ne regrette rien : « Il fallait que cela soit fait. Bien sûr, j’aurais préféré partir en Afghanistan, au moins j’aurais été utile… »
Ce qui l’inquiète le plus, finalement, c’est ce toit qui s’écroule. Cela fait 47 ans qu’il vit dans cet appartement, depuis qu’il a commencé son travail de forgeron à l’usine d’Akhmetov. « J’ai frappé à toutes les portes du gouvernement. Partout, on m’a éconduit. Alors les amis de mon fils sont venus colmater les trous faits par les éclats d’obus. Ici, le pouvoir comme le poisson pourrit par la tête. Et Zelensky est un clown. » Le héros de Tchernobyl avoue qu’il regrette le temps béni de l’Union soviétique. Pour lui, seul Poutine, « l’homme politique le plus puissant du monde », pourrait redorer le blason de l’Ukraine. Et dans son appartement glacé, l’ancien forgeron rêve du moment où Avdiivka reviendra dans le giron de la grande Russie.
Les babouchkas de la ligne de front
Sa maison est adossée à un terril couvert de neige. Un nid de snipers séparatistes qui, de ce point culminant, balaient la plaine de leur viseur. C’est la toute dernière maison avant les tranchées de l’armée. Quand Lydia Petrovna, 85 ans, vient nous ouvrir la porte, les mitraillettes crépitent, puis deux obus explosent coup-sur-coup à quelques centaines de mètres, à côté du châssis-à-molette de la mine. Elle est heureuse de nous voir, elle a eu peur que l’on renonce à lui rendre visite avec l’ONG tchèque « People in Need », qui lui apporte un soutien alimentaire et médical. Lydia n’a plus de famille, alors elle est restée là, dans son village de Marinka où les maisons grignotées par la végétation ont perdu le combat. La vieille dame vit seule, sans électricité ni eau courante. Deux fois par mois, un camion-citerne livre de l’eau. « Depuis huit ans, je vis avec ma chatte, Mathilda. Elle est moi sommes des survivantes de guerre ! » Lydia ne compte plus les obus qui sont tombés dans son jardin, alors elle s’est contentée de calfeutrer ses vitres avec du bois et des couvertures. Ce matin, elle a entendu un bruit dans le jardin : elle a eu peur des pillards et a ramené sa provision de charbon dans la maison. Son père, qui combattait dans l’armée rouge, n’est jamais rentré de la « Grande Guerre patriotique » de 1941-45. Son mari et sa sœur sont morts pendant la guerre de 2014. Lydia n’a pas pu réaliser le vœu de cette dernière qui vivait du côté séparatiste mais voulait être enterrée avec sa mère du côté ukrainien. A tout prendre, quand on l’interroge, elle dit que « la Seconde Guerre mondiale a eu un début et une fin. C’était une guerre bien franche, et après la paix pour tout le monde ! Tandis que celle-ci, soupire-t-elle, personne ne sait si elle finira un jour… » Elle ajoute avant que nous la quittions : « Surtout dites-leur bien que nous sommes toujours en guerre ! Les chaines de télé ne veulent pas montrer les combats, alors le monde ne sait pas que nous souffrons et qu’il y a des blessés ou des morts chaque semaine ! »
Cette recommandation toutes les babouchkas des villages qui s’étendent sur la ligne de front l’ont prononcée : « Racontez-leur comment on vit ici ! » Comme Nadiezhda, 76 ans que nous avons rencontré dans son jardin alors qu’elle venait accueillir son mari Nikolai, 77 ans, qui revenait d’avoir péché dans le lac gelé d’Opytne. Elle, c’est quand elle n’entend plus les bombardements qu’elle s’inquiète. Les tuyaux sont détruits, il n’y a ni gaz ni eau, mais le couple ne veut pas quitter sa maison : « Pour aller où ? Personne ne nous attend et nous avons mis des dizaines d’années à acheter notre maison. On ne rénove pas, pourquoi faire ? Nous vivons au jour le jour, et puis il n’y a plus rien à viser tout est détruit ! », s’esclaffe la vieille dame. « Le problème c’est le gouvernement ukrainien qui ne fait rien pour nous aider. » Nadiezhda n’a pas vu ses enfants depuis 2014, et elle ne connaît pas ses petits-enfants. « Avant, pour aller à Donetsk, on mettait une quinzaine de minutes. Aujourd’hui, le voyage dure près de 30 heures : il faut passer par la Russie et à chaque check-point, d’un côté comme de l’autre, il faut graisser la patte… » Sa belle-sœur, Anna, 70 ans, dont la moitié de la main a été emportée dans une explosion en septembre 2014, regrette le bon vieux temps de l’Union Soviétique. « Si vous aviez vu Opytne à l’époque ! les jardins en fleurs, la beauté des aubergines et des haricots, nous étions un village agricole modèle. Et puis, après la perestroïka, tout est allé de mal en pis. On recevait nos salaires en retard et ils ont fini par délocaliser la production de légumes. »
A Slavne, une autre localité sur la ligne de front, dans l’immense plaine couverte de neige, on voit de loin le hangar agricole bombardé. Irina et sa fille Christina, âgée de 17 ans, se sont retranchées dans le bâtiment attenant. Elles vivent ici, au milieu de leur ferme, dans une petite baraque qu’elle se sont fabriqué à côté de leurs veaux, dans les odeurs de purin qu’elles ne sentent plus. Elles ont renoncé à élever des cochons : ils n’arrêtaient pas de sauter sur les mines qui jonchent les champs… Christina s’est fait une belle coiffure parce que c’était la fête du nouvel an à l’école. Elle en a profité pour peindre les ongles de sa mère en rouge carmin. Pour celle-ci, c’est trop tard. Mais la jeune fille, sous le regard fatigué de sa mère, nous le promet les yeux brillants : un jour, elle deviendra esthéticienne loin d’ici, et quittera les odeurs de la ferme et la prison de cette guerre sans fin.
Février 2014 : à Kiev, la révolution orange renverse le pouvoir pro-russe et affirme sa volonté de rejoindre l’UE et l’Otan.
Mars 2014 : dans le sud, un référendum local, organisé sous pression russe, proclame le rattachement de la Crimée à la Russie.
Avril 2014 : dans l’est, des groupes armés pro-russes proclament à leur tour l’indépendance des régions de Donestk et Lougansk.
Mai 2014 : l’armée ukrainienne intervient dans les régions séparatistes mais est stoppée par les rebelles soutenus par des militaires russes.
Février 2015 : après l’échec de Minsk I, les accords de Minsk II établissent un cessez-le-feu qui diminue enfin l’intensité militaire du conflit.
Décembre 2020 : sous prétexte d’exercice, la Russie masse 100.000 soldats aux portes de l’Ukraine et exige que l’Otan renonce à toute extension près de ses frontières.
Janvier 2021 : excluant les européens, Vladimir Poutine veut négocier directement avec Joe Biden les termes d’une désescalade militaire.
L’article Ukraine : <strong>La guerre gelée du Donbass</strong> est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Afghanistan : être une fille sous les talibans est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>La jeune femme venait alors de terminer sa dernière année à la faculté de sciences politiques. Elle rêvait de devenir ambassadeur, de voyager dans des pays lointains. Aujourd’hui l’émirat islamique lui a volé ses rêves et voudrait la cantonner dans sa maisonnette sur les hauteurs de Kaboul. Une femme ne peut voyager à plus de 45 km de chez elle sans sponsor, alors représenter son pays à l’étranger… Courageusement, elle a décidé d’ouvrir une école clandestine pour toutes les jeunes filles qui n’ont plus le droit d’aller à l’école. Car dans leur nouveau code de lois qui traduisent leur volonté de naviguer entre les exigences de la communauté internationale et leur ADN rétrograde, les talibans autorisent encore les filles à fréquenter l’école primaire et la faculté. Mais ils leur ont décrété que la porte de l’enseignement secondaire leur serait désormais fermé. Officiellement pour des questions de budget. En réalité parce que, pour ces ayatollahs de la « pudeur », il n’est pas convenable pour des jeunes filles en pleine puberté de sortir de chez elles et que la fin du lycée, c’est logiquement une façon d’en finir progressivement avec l’université et l’enseignement supérieur pour les femmes… Alors tous les soirs à 5 heures, une trentaine de jeunes filles se pressent chez Fatima à même le sol pour continuer à apprendre coute que coute. Elles sont rejointes par des garçons, jeunes ou plus vieux qui cherchent des cours de perfectionnement. Dans une désordonnée mais joyeuse mixité, le comble de la subversion aux pays des talibans, on apprend dans la maison de Fatima, le dari, le Coran ou les mathématiques. Et surtout la ténacité. La jeune fille dévore les livres, surtout anglosaxons, qui expliquent comment atteindre ses objectifs, ne pas être découragé par l’adversité et les élèves adorent ses leçons d’optimisme. Nous avons passé l’après-midi avec Fatima, fascinées par sa détermination. Entre deux leçons, elle nous a confié que comme trois quarts des Afghans, elle aimerait quitter le pays. Lorsque nous lui avons demandé si elle était fiancée, elle a levé les yeux au ciel « je viens d’une famille éduquée et je veux poursuivre mes apprentissages, pas devenir la femme de ménage d’un homme comme la plupart des amies de ma mère… » La plupart de ses élèves veulent devenir doctoresses « pour aider les femmes afghanes » et aussi par pragmatisme puisque c’est désormais le seul métier féminin que tolèrent les Talibans avec celui d’infirmière ou de sage-femme. Au bout d’une heure, sans doute intriguées par les étrangères qui étaient sur la terrasse de Fatima, trois filles de talibans du quartier, vêtues de ces niqabs intégraux qui ne laissent voir que les yeux ont frappé à la porte de la maison, feignant de chercher les cours du soir de la mosquée. Fatima les a chassées fermement avec un mépris non dissimulé pour ces endoctrinées qui voudraient ramener les femmes de son pays à l’âge de pierre. Crânement, elle est sortie avec nous au marché pour acheter un immense tableau, des feutres et des cahiers. Et à la librairie, elle déniche un nouveau livre de « self improvement » venus des Etats-Unis qu’elle va se dépêcher de ficher pour le transmettre à ses petits étudiants. En espérant des jours meilleurs.
A l’université de Kaboul où nous avons pu nous introduire, en trompant la vigilance des talibans qui gardent les portes, un groupe de jeunes filles déjeunent sur la pelouse de l’université. Elles étudient toutes des matières médicales, certaines pour devenir sage femmes d’autres dentistes pour femme, ou kiné pour femmes, ces métiers « genrés » qui sont les seuls tolérés par les talibans. Lorsque le taleb qui vient de nous repérer, nous demande de quitter immédiatement les lieux sous peine de très graves ennuis, elles nous font signe pour que nous les suivons à la cafétéria des filles. Elles sont ultra chics et sous leurs manteau noirs cintrés, griffées de la tête aux pieds. Faux sacs Vuitton, voiles à carreaux Burberry, bottines à talon. Comme toutes les étudiantes, elles pianotent sur leurs portables, parlent de leurs examens et de leurs peines de cœur. Elles ont beau n’avoir jamais vu les garçons avec qui elles correspondent, leurs histoires n’en sont pas moins passionnelles. L’homme avec qui correspondait Zeinab depuis plusieurs mois, l’a « abandonné » pour aller épouser, dans la vraie vie cette fois, une afghano américaine, la promesse d’un visa pour les Etats-Unis. On peut avoir le cœur brisé sur Instagram …
L’éducation des femmes, c’est la grande obsession des talibans. Au gouvernement, le camp des rétrogrades qui a pour l’instant le dessus s’affronte avec celui des « progressistes ». Ainsi le chef de la cour suprême, le ministre de la Justice et celui des affaires religieuses sont contre l’école pour les femmes. Tandis que le fils du mollah Omar, le mollah Yacoub, le ministre de l’Intérieur, Sirajuddin Haqqani et le mollah Baradar qui a mené les discussions à Doha avec les Américains présidant à leur retrait, sont pour. Entre eux, la bataille se déroule sur les réseaux sociaux ou chacun expose ses arguments à fleuret moucheté. Celui que développent souvent les progressistes sur twitter, c’est le fait que le gouvernement des talibans n’aura pas de deuxième chance et qu’il faut se montrer pragmatique pour être reconnu par la communauté internationale. Le mollah Baradar aurait confié en sortant d’une réunion au palais présidentiel, que le plus rétrograde sur la question est Amir Khan Muttaqi. C’est lui qu’il s’agirait de convaincre. Mais justement celui-ci n’entend pas céder aux injonctions des occidentaux. Quant aux talibans de base, ils aimeraient eux, interdire tout simplement l’accès des femmes à la vie publique…
On nous avait dit qu’à Herat ville des poétes et des musiciens sous influence iranienne, l’étau des Talibans sur la société et sur les femmes en particulier était moins oppressant ;
Sans doute parce que dans cette ville traditionnelle, l’empreinte religieuse est si ancrée que les talibans étaient sont moins tentés d’y exercer leur sinistre police. De fait, dans la troisième ville d’Afghanistan, la présence des « étudiants en religion » est moins forte qu’à Kaboul. Petit à petit, les Heratis ont même obtenu certains accommodements avec la loi d’airain des talibans. Ainsi, si les femmes ne peuvent plus passer le permis de conduire, celles qui l’ont déjà obtenu peuvent en principe conduire. Sous la pression des commerçants, les restaurants qui étaient un moment réservé uniquement aux hommes ont recommencé à accueillir des familles. Dans le plus grand restaurant de la ville, justement un groupe de femmes déjeune entre elles dans un des petits salons particuliers réservé aux familles. Une médecin de la grande maternité d’Herat, nous explique avec le sourire qu’elle espère que la situation des femmes va s’améliorer : « un des commandant taleb de la ville s’est agacé que sa femme enceinte ne puisse pas passer son échographie avec un radiologue femme. Il m’a dit que c’était pour cette raison qu’il était pour la réouverture des lycées ! »
Devant les distributions de nourriture du Programme Alimentaire Mondial de l’ONU, une jeune fille couverte d’un tchador noir fait la queue. Marjane, 22 ans, était présentatrice de journal télévisé lorsque les talibans ont pris le pouvoir et l’ont renvoyé chez elle. Aujourd’hui elle a repris des études de sage-femme pour ne pas perdre son temps pendant ce qu’elle espère être une triste parenthèse de l’histoire de son pays. Son père a pris une seconde épouse et ne rend plus guerre visite à sa mère, tout l’argent qu’elle gagne en confectionnant des gâteaux ou des bijoux sert à financer ses études. Elle nous accompagne dans la ville, mais à part à la mosquée et au fort, nous nous heurtons vite aux limites de la nouvelle liberté des femmes en régime taleb. Le gardien du parc de Tarti safar nous refoule. Il est désormais réservé aux hommes et des jeunes gens arpentent les allées ou font des tours de bateau en plastique entre eux. Marjane s’indigne, explique notre statut de journaliste qui nous permet en principe et malgré notre sexe d’entrer dans les lieux réservés aux hommes. Le gardien nous autorise finalement un petit tour bien encadré pour que nous nous rendions compte de l’immense liberté dont nous disposons, d’ailleurs comme nous l’expliquera Haziz ul Rahman al Mojaher, le directeur du ministère du Vice et de la Vertu d’Herat « ce sont les femmes qui ont demandé la ségrégation dans les parcs, elles ne cessaient d’être importunées et puis tout le monde sait que ce sont des lieux de débauche », une fois l’enceinte du parc franchie, tous les curieux se rassemblent autour de nous pour voir qui ose braver la loi des talibans.
Vivre dans l’Afghanistan des Talibans, cela s’apparente à vivre une vie en liberté surveillée. Mais pour les filles qui étouffent sous ce régime d’apartheid strict, c’est une vie en prison régie par d’innombrables règles. Interdiction de courir dans la rue, de pratiquer du sport, d’emprunter les mêmes entrées que les hommes, de voyager sans chaperon, de passer son permis de conduire. De fait les femmes afghanes sont des citoyennes de seconde zone, des dhimmis en leur propre pays. Ainsi pour entrer dans l’enceinte de la prison d’Herat, lorsqu’on est une femme, il faut emprunter un passage étroit coincé entre un arbre et un mur. Sous bonne escorte nous aurons le droit, non de visiter les 300 prisonnières de la ville, mais la trentaine de condamnées à des peines de mœurs. La plupart des femmes que nous rencontrons dans cette aile, sont incarcérées pour « adultère » c’est-à-dire dans le vocabulaire de l’émirat islamique pour avoir eu un commerce avec un homme sans être mariées. A voix basse, elles nous supplient de les aider à sortir. Pour certaines d’entre elles, cela fait des mois qu’elles attendent d’être jugées. Zeinab, la gardienne de prison nous explique que l’adultère est passible d’un an de prison ou de quelques semaines plus de coups de fouets selon la gravité de la peine. Mais comme nous l’expliquera le chef du tribunal d’Herat, tout en administrant des coups de fouets à un jeune vendeur occasionnel de drogue a l’aide une longue lanière en cuir souple (un châtiment destiné à punir les peines les plus légères » nous explique sérieusement un juge), il y a eu des consignes de clémence du sommet de l’état taleb vis-à-vis de ces femmes et toutes devraient bientôt sortir… Sauf celles qui sont en prison pour les protéger d’une société trop violente vis-à-vis des femmes. Comme cette jeune femme que la misère a poussée à aller chercher du travail en Iran. Refoulée par la république des mollahs, on l’a placée ici, pour qu’elle ne soit pas condamnée à errer dans les rues d’Herat.
A l’Université d’Herat, les règles sont moins strictes qu’à celle de Kaboul. Ici, en raison de la pénurie de professeurs, des hommes font aussi la classe a des étudiantes, en attendant de nouvelles embauches que la crise économique rend assez peu probables. Le recteur, Abdul Haziz Nomani est un taliban modéré qui essaye de nous expliquer qu’il est pour l’éducation des filles sans remettre en cause toutefois les récentes directives du gouvernement. « J’espère que les filles pourront accéder à l’éducation secondaire dans le respect des lois islamiques. Il n’y a pas de société libre sans éducation ! » Dans le jardin de la faculté, un employé nous explique que depuis l’arrivée des taliban, la ville est devenue beaucoup plus sure pour les femmes… : « Quand ils sont arrivés l’année dernière j’ai pensé que mon pays était fichu. Mais non, cela va de mieux en mieux. Avant, Hérat était la ville des kidnappings. Il y en avait plusieurs par semaine. Mais il y a quelques mois, quatre soldats talibans ont enlevé des hommes pour obtenir une rançon. Le gouverneur taleb d’Herat, le cheik Nourredine Mohammad Islam jar, les a convoqués et les a fait exécuter d’une balle dans la tête chacun. Ils s’appliquent à eux-mêmes leurs lois ! » Comme pour illustrer cette déclaration, Marjane, l’ex-journaliste de télévision, coiffée d’un hijab rouge vif est venue seule en rickshaw nous dire au revoir à l’hôtel à la tombée de la nuit. Mais elle nous apprend ses fiançailles avec un dentiste que lui a présenté sa mère : « si je veux rester en Afghanistan, c’est la meilleure des solutions » admet-elle.
L’article Afghanistan : être une fille sous les talibans est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Mariages précoces est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>C’est l’accorte taliban chargé des journalistes au ministère des affaires étrangères à Kaboul, qui en nous accueillant pour nous préciser les nouvelles lignes rouges à ne pas franchir pour la presse, nous a alerté sur le sujet radioactif. « Vous pouvez enquêter sur tout mais dans le cas des sujets sensibles comme celui du mariage précoce des jeunes filles, venez nous signaler le nom des coupables. Le mariage des enfants est interdit en Afghanistan. Alors, soit nous mettrons en prison les pères qui ont vendu leurs filles, soit nous rachèterons leurs dettes ». Plus tard, à Kaboul on nous avait dit que la misère des habitants des camps de la région de Badghis, au nord-ouest du pays, avait conduit certaines des familles à se résoudre à ce qui, dans l’Afghanistan tribal, est un moyen traditionnel pour s’acquitter d’une dette : la vente à tempérament d’une toute jeune fille à son beau-père ou à son futur mari. Alors après avoir atterri à Herat, une ville de l’ouest du pays, imprégnée par l’influence iranienne jusque dans la forme du tchador des femmes, nous avons pris la route qui conduit à Badghis, la région la plus pauvre d’Afghanistan à la frontière du Turkmenistan. Après trois heures d’une piste ponctuellement asphaltée qui serpente dans un paysage grandiose de canyons ocre et d’oasis émeraude bordés de villages séculaires en pisé, nous avons atteint Qala-e-nau, la capitale de la région. Là, comme à chaque halte, le voyageur doit s’arrêter chez le représentant de la culture du gouvernement des taliban. La mise en garde de cet homme à la barbe fournie posant à côté du drapeau blanc de l’émirat s’est faite cette fois plus menaçante : Il est formellement interdit de poser des questions sur les mariages de jeunes filles au risque de ne plus pouvoir remettre les pieds dans le pays. Voire pire. Sous le regard empreint de reproche de mon traducteur afghan qui n’a jamais été chaud pour que nous entreprenions ce périple, j’obtempère. Nous ne pouvons risquer de mettre en danger le permis de travail des O.N.G qui nous accueillis. Alors nous nous limiterons à enquêter sur l’extrême pauvreté des familles de la région, un sujet qui a la faveur des talibans puisqu’il devrait permettre de remobiliser l’aide internationale au développement qui a déserté le pays depuis leur arrivée au pouvoir.
« Quand les petits commerces ne me font plus crédit pour nourrir ma famille, je sacrifie une de mes filles ». Je n’ai pas sollicité cette remarque d’un des habitants qui vient à notre rencontre à l’entrée du camp de Badghis. Ici s’entassent 2700 familles dans des tentes ou des casemates en pisé. Le malek du camp (le représentant) nous fait asseoir dans une de ces tente et raconte la malédiction de ces agriculteurs- réfugiés qui ont tout perdu pendant ces sécheresses qui se succèdent de plus en plus souvent et à cause de la guerre. « Ils ont si faim que certains n’ont pas d’autre choix que de vendre leurs filles », m’explique-t-il sans gêne particulière. Lorsque je demande à rencontrer ces hommes qui ont cédé leur enfant comme une marchandise, c’est Rajab, le père de Sherafzada, un homme de 58 ans à la grande barbe blanche, que l’on me présente d’abord. Puis arrive Mohamed Nasim qui a vendu ses deux filles de 8 ans et de 6 mois
« Le gouvernement des talibans ne nous aide pas parce qu’il voudrait que nous rentrions dans nos villages. Mais comment le pourrions-nous ? il nous fallait déjà faire 45 km pour aller au puits le plus proche lorsque nous sommes partis » explique le Malek. « Ici nous achetons la bouteille d’eau 15 afghanis(16 centimes d’euros), et louons nos tentes entre 50 et 100 afghanis, (50 centimes à un euro) par mois, le sac de farine est passé de 1500 afghanis à 5000 afghanis (de 16 à 54 euros). Comme vendeurs ambulants ou décortiqueurs de pistaches, nous gagnons 40 afghanis (15 euros) par jour, nos dettes s’accumulent, alors quand il n’y a plus de meubles à vendre, on marie nos filles… » Pendant que le chef du camp parle, des hommes entrent dans la tente avec leurs filles vendues. A l’extérieur ce sont les femmes qui poussent devant elles les très jeunes mariées. Il y en a dix, puis cent, enfin c’est une marée concentrique d’enfants apeurées, certaines mal peignées d’autres apprêtés de bijoux et maquillées de khôl qui entourent la tente. Aucune ne sourit. Elles ont compris que nous parlions d’elles. « Ou ces gens vont-ils nous emmener » murmure l’une d’entre elles avec angoisse. Les hommes haussent le ton, chassent sans ménagement les femmes qui tiennent des bébés dans les bras, des abords de la tente. Est-ce que toutes ces petites filles sont mariées ? « Je dois vous dire que la majorité des filles du camp ont été vendues » reconnait le Malek « J’en connais même une qui a été mariée alors qu’elle n’avait que 40 heures pour 10000 afghanis » Et puis il y a Aynudin 5 ans dont le père a perdu ses 500 moutons pendant la sécheresse. Halima 10 ans dont le père est tombé dans une terrible spirale le jour où il a contracté l’appendicite. Et puis Hadjira, 12 ans, Sumaya,12, Sakina 10 ans, Gulista 10 ans, Khotereh 7 ans, Mariam 5 ans, Sima 10 ans et tant d’autres dont les petits visages aux yeux tristes dansent une ronde macabre dans ma mémoire. Bientôt c’est l’émeute, tout le monde veut parler, montrer sa fille, son bien, son trésor. Les témoignages se chevauchent et on ne sait plus qui est qui dans cette cour des misères ou toutes les histoires se ressemblent. Il faut partir, cette agitation va être repérée par les talibans qui surveillent les abords du camp. Déjà ils nous appellent pour nous rappeler à l’ordre…
Selon un rapport de l’Unicef de 2018, 42% des familles afghanes ont une fille qui se marie avant l’âge de 18 ans. Le phénomène ne date pas des talibans. Mais il a été sans doute décuplé depuis leur arrivée et le départ des Américains à cause de la situation économique effroyable qui en est résulté et de la méfiance qu’entretiennent les Étudiants en religion vis-à-vis des ONG qu’ils soupçonnent d’ingérence. En Afghanistan depuis toujours, dans les familles les plus traditionnelles ou les plus pauvres, on marie parfois sa petite fille pour résoudre une querelle, ou pour resserrer les liens entre deux familles un peu comme dans la Corse du 18 -ème siècle. Mais le plus souvent c’est le « Baad », le mariage qui sert à s’acquitter d’une dette. En l’absence de système bancaire, l’enfant est le dernier bien dont on dispose » explique le représentant d’une ONG à Hérat. Ainsi le mariage est souvent perçu comme le moyen d’assurer la survie d’une famille. Mais les filles mariées tôt encourent aussi de graves risques, des accouchements compliqués aux violences conjugales ou familiales. Pour l’époux, acheter une fille jeune est avantageux, car elle coûte moins cher en dot qu’une femme plus âgée et l’argent est le plus souvent versé en mensualités annuelles : tant que la somme finale n’est pas versée, la jeune fille peut normalement rester vivre chez ses parents au moins jusqu’à sa puberté. « Et puis s’il se lasse, il peut toujours la répudier ou s’en servir comme d’une femme de peine. La vie de ces enfants mariés est souvent un calvaire… » continue cet humanitaire qui connait bien la question. On se souvient de ce terrible fait divers qui s’est passé dans la province de Badghis, en 2018 : Hameya, 7 ans, avait épousé Ashraf dans le cadre d’un « badal », un mariage avec échange de filles. Théoriquement interdites en Afghanistan, ces unions se pratiquent toujours, surtout dans les provinces reculées. Le frère d’Hameya avait épousé il y a six mois une fille de la famille d’Ashraf et en retour, on a donné Hameya à Ashraf, qui était déjà marié. Lorsque le frère d’Hameya a tué sa femme, Ashraf s’est vengé en torturant cruellement la fillette de sept ans avant de l’étrangler… L’histoire ressemble à une vendetta corse des siècles derniers. Lorsqu’on y commettait un homicide, la parentèle victime se devait de rétablir l’équilibre sous peine de honte (vergogna). La honte frappait tout individu qui ne vengeait pas son déshonneur(rimbeccu). D’où l’intérêt, dans ces sociétés claniques, de marier sa fille dans sa tribu.
Le fléau des mariages d’enfants s’étend aussi aux camps de déplacés d’Hérat, la troisième plus grande ville afghane. De retour dans la ville, nous nous dirigeons vers le camp de déplacés, une ville de maisons en pisé à la périphérie d’Hérat, un lieu-dit appellé Sharak Sabs. Après le petit marché où les couleurs éclatantes des tuniques des hommes contrastent avec le spectacle des étals à moitié vides, nous nous arrêtons au hasard devant le premier pâté de maison. Le mollah Abdul Rahim, l’imam qui guide les consciences des 25 maisons du quartier est arrivé ici comme tous les autres habitants, il y a trois ans, chassé par la sécheresse et les talibans. Il admet, mal à l’aise, que depuis son arrivée il a célébré 12 cérémonies de mariage de petites filles. Le dernier, il y a quelques jours à peine, célébrait le mariage de la petite Zar Tsanga, trois ans, qui a été vendue par son père pour 70000 afghanis (760 euros) à un ex policier du centre d’Herat qui cherchait une femme pour son fils. « Nous n’avons plus rien. Que voulez-vous que l’on fasse. Dans notre quartier une femme a un cancer du sein, une autre de l’estomac. Les petits garçons sont envoyés à Karachi au Pakistan pour ramasser les ordures et les filles vendues aux plus offrant… » s’excuse l’imam. Alors devant le malek du quartier, le père de la fillette, et l’acheteur qui ont servi de témoins, aux « mariés » il a prononcé ces paroles du Coran qu’il me récite par cœur : « il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seul, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille » Le père de Zar Tsanga, arrive justement de la ville. Il me montre son attelle, il a reçu une balle dans la jambe pendant la guerre avec les talibans, il ne peut plus travailler, alors il a dû se résoudre à vendre sa fille pour que les autres membres de sa famille puissent survivre. Il l’embrasse, la câline, joue avec ses boucles rousses de henné. Il a l’air d’aimer tendrement son enfant. La petite impressionnée ne lâche pas la main de sa meilleure amie, une toute petite fille que nous avions vu à l’aube ramasser les détritus du camp pour aller les vendre et qui regarde interloquée ces étranges visiteurs qui la prennent en photo. Le père a aussi proposé à l’ex-flic d’acheter sa petite dernière âgée d’un an pour pouvoir payer son opération mais quand on lui a appris que sa blessure ne pouvait être soignée qu’au Pakistan, il a renoncé au marché. Dans la maison aux murs de terre séchée de Zar Tsanga, les femmes de la famille sont réunies, il y a la grand-mère de Zar Tsanga. Elle a eu six filles, aucune n’a été vendue « de mon temps la situation économique n’était pas aussi mauvaise » soupire-t-elle. Guldana, 30 ans, la mère de Zar Tsanga nous apprend que sa fille était promise à un autre homme « mais il vivait loin et nous avons préféré marier notre fille a quelqu’un de notre tribu ; c’est plus sûr. Sinon nous risquions de ne plus jamais la revoir » Car le policier Daoudo est membre de la tribu des Bainza. « C’est un homme bon » continue Guldana « il l’a acheté pour que nous puissions faire soigner Mohamed » une affirmation surprenante aussitôt nuancée par Marbouba la sœur de Guldana : « Pour l’instant Daoudo n’a versé que 5000 afghanis et pourtant il veut prendre Zar Tsanga tout de suite : il dit qu’elle est sa propriété… Croyez-moi, ici il vaut mieux avoir des garçons. Quand on a des filles on nous les enlève, c’est terrible pour une mère… » A côté d’elle le visage caché par son voile, sa fille Massouma, 17 ans. Elle a été mariée à 11 ans et a fait une fausse couche d’avoir enfanté trop tôt. Depuis elle est stérile. Une nouvelle que l’on a du mal à considérer comme mauvaise dans ces circonstances, même si on se doute bien dans cette région qui n’est jamais clémente pour les femmes, qu’elle peut avoir des conséquences (répudiation ou ostracisme) pour la jeune fille. Selon une enquête de 2010 sur la mortalité effectuée par le ministère de la Santé publique afghan, 47 pour cent des décès de femmes âgées de 20 à 24 ans étaient liés à la grossesse. L’enquête a constaté qu’une femme afghane meurt toutes les deux heures pour cause de grossesse. Les mariages d’enfants et les grossesses précoces contribuent également à la fistule, une blessure évitable à l’accouchement dans laquelle le travail prolongé crée un trou dans le canal de naissance. Un rapport du gouvernement de 2011 a révélé que 25 pour cent des femmes et des jeunes filles atteintes d’une fistule avaient moins de 16 ans quand elles se sont mariées et 17 pour cent avaient moins de 16 ans quand elles ont donné naissance pour la première fois. La fistule provoque une fuite d’urine ou de selles qui aboutit souvent à l’ostracisme social, des frais médicaux pour le traitement et la dépression. Si elle n’est pas traitée, la fistule peut entrainer la mort. Les enfants nés à la suite de mariages d’enfants présentent également des risques accrus pour la santé. L’enquête de 2010 sur la mortalité a révélé un taux de mortalité plus élevé chez les enfants nés de mères afghanes âgées de moins de 20 ans par rapport à ceux nés de mères plus âgées, ce qui reflète les constatations au niveau mondial.
Daoudo arrive dans sa dishdasha d’un blanc immaculé « que me voulez-vous, j’ai quitté mes affaires pour vous rencontrer ? » Il a un certain embonpoint qui est souvent ici un signe d’opulence et contraste avec la maigreur des habitants du camp, « Cela va bien pour moi, j’ai de quoi vivre » nous explique satisfait l’ex policier « alors j’ai proposé d’acheter Zar Tsanga pour la marier à mon fils » dit-il en tapotant la joue de la petite fille « pour leur rendre service et puis pour rapprocher nos familles ! » Dans le camp, les hommes le traitent comme un bienfaiteur. Peut-être espèrent-t-ils d’autres largesses de cet homme qui n’a pas l’air de lâcher son argent sans contrepartie. A côté de lui, une vieille dame dont le sein est rongé par un cancer galopant nous appelle au secours. Dans ces reportages aux confins de la misère, les lignes se brouillent et nous savons que nous ne pourrons pas partir sans voir les malades. Le chef du village a beau avoir compris que nous ne sommes ni médecin, ni humanitaires, c’est une question de compassion. J’examine effarée les peaux meurtries, les cicatrices mal refermées, les cancers purulents de ces gens qui n’ont rien et surtout pas de soins médicaux. Sur un matelas jeté sur le sol, Abdel Karim, un homme de la famille du malek a l’air de souffrir le martyre. IL y a deux semaines, on lui a retiré un rein. Il me dit qu’il souffre d’une hépatite C. Son teint est jaune, il n’a plus de forces, vomit tout ce qu’il ingère et nous décidons de le conduire à l’hôpital d’Herat. En chemin j’hésite à lui poser la question dont je connais déjà la réponse. A-t-il vendu sa fille lui aussi pour pouvoir faire son opération ? « Oui ma fille de quatre ans, Leila, puis mon terrain à Badghis. Désormais je n’ai plus rien » A l’hôpital nous apprenons que Abdel Karim souffre d’un carcinome qui a métastasé dans le pancréas et les poumons. Qu’il est en phase terminale. Le médecin me dit que la morphine lui est déconseillée et je ne réussis qu’à lui procurer trente ampoules de tramadol et autant de seringues, dérisoire chimiothérapie pour le soulager dans son agonie…Le lendemain, lorsque nous retournons au camp prendre de ses nouvelles, nous le trouvons allongé avec sa petite Leila dans les bras. Il a passé une bonne nuit grâce au tramadol et tout le monde veut désormais me parler de ses douleurs. Dans une des pièces voisines, Daoudo, le propriétaire de Zar Tsanga a passé la nuit. On l’a installé comme un prince, sur le plus beau tapis du camp. Parce que rien n’est simple au pays des mariages d’enfants, je comprends, impuissante devant l’immense détresse de ces gens qu’il est le dernier espoir des déshérités de Sharak Sabs.
L’article Mariages précoces est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article A Izioum, après 164 jours sous la botte russe : « Maudit Poutine, dites bien ce qu’il nous a fait, tout le monde doit savoir » est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>
Devant la morgue, entre deux haut-le-cœur, un homme crie son impuissance. La police lui a demandé de venir chercher le corps de son frère mais la babouchka de service à l’accueil ne cesse de lui présenter des cadavres bleutés sans les tatouages qu’il portait sur les bras. La morgue n’a pas été réfrigérée depuis six mois, et la petite grand-mère est dépassée par la métamorphose des corps qui s’entassent. Ce n’est pas la guerre qui a tué Micha, pas directement. Quelques jours après la libération de la ville par les Ukrainiens, sa femme l’a quitté et Micha s’est pendu.

Une femme sur le perron de sa datcha insulte les journalistes venus l’interroger : « Que voulez-vous savoir ? Que le corps de mon fils tué par les Russes a flotté dans la rivière pendant trois mois ? Dégagez ! » Sur la place, devant le camion de l’aide alimentaire, deux femmes en viennent aux mains pour une miche de pain blanc. Assis sur un banc, au pied d’une barre d’immeuble, un homme pleure : « Ils m’accusent d’avoir collaboré, mais est-ce un crime que de vouloir rester chez soi ? Je n’ai fait que vendre les champignons ramassés dans la forêt ! » Devant l’hôpital militaire, Sergueï Petrovitch Botsman, ambulancier en chef, vocifère contre les soldats ukrainiens alcoolisés qui ont fêté leur victoire tard dans la nuit en tirant de longues salves vers les étoiles. Sergueï est un héros : il a passé toute l’occupation à convoyer des civils sur des brancards. Lorsque les bombardements commençaient, il montait à Kremenetz, la colline qui surplombe la ville, pour repérer où tombaient les missiles avant de s’y précipiter pour ramasser les blessés. Pendant toute la durée de l’occupation russe, il a refusé d’enlever son écusson aux couleurs de l’Ukraine, mais aujourd’hui il a besoin de dormir. A Izioum, les héros aussi, sont fatigués.

La chasse aux collabos
Dans cette ville de l’est ukrainien, plusieurs centaines de sépultures ont été découvertes après le retrait des troupes russes. Pour y témoigner des crimes russes, Zelensky avait invité la presse internationale à assister aux exhumations des corps du cimetière « Shakespeare », dans la forêt de grands pins qui longe la bourgade. Mais à Izioum, à la litanie des morts s’ajoute le récit des survivants : détruite à 80%, cette ville fut aussi un laboratoire de l’occupation russe. Pendant six mois, les 15000 Ukrainiens qui y sont restés ont dû subir la loi d’airain des hommes de Poutine. Et aujourd’hui l’heure des comptes a sonné. Collabos, salauds, héros, chacun a des noms en tête.
A la mairie, par exemple, le vice-maire Volodymir Vatsokine, revenu le 13 septembre, me récite d’une traite la liste de ses concitoyens frappés d’indignité. Au moment où ils évoquent leur nom, ils sont soit en fuite en Russie, soit interrogé par l’armée dans un lieu sûr. « Il y a Anatoli Fomichevesky, membre du gouvernement local ; Oleksander Pachkov, directeur de l’hôpital ; Lubov Goja, directrice des programmes de russification. Et puis il y a Galina Zavalichina ; Oleksander Zaporochenko ; Lubo Katchenko ; Maxim Chtelemark ; Natalia Malik ; Ivgueni Martinov. » On n’arrive plus à l’arrêter. A la tête de ce clan d’indignes, poursuit le vice-maire, se trouve « Vladislav Sokholov ». Avant la guerre, ce dernier était déjà suspecté d’être un agent dormant dont le fils servait dans la marine russe basée à Sébastopol. Cet ex-policier, vendeur de drogue, se présentait à toutes les élections, qu’il perdait toujours. Il était flanqué de son adjoint, Hleb Tkachenko : « Lui, c’était le vrai salaud, le type cynique, capable de tout. » Le vice-maire voudrait qu’on fasse une loi pour dérussifier l’Ukraine. « Par exemple, nos professeurs qui sont partis se ‘‘former’’ en Russie ne devraient pas pouvoir reprendre leur travail ici ! » Il faudrait également traiter les cas de « tous ceux qui ont dénoncé leurs voisins, leurs cousins ou leurs collègues aux Russes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de lettres de dénonciations qu’on a retrouvé dans les papiers abandonnés », affirme le vice-maire. « Cette idée de dérussification de la population est dangereuse ! » commente Bilke Willis de l’organisation humanitaire « Human Right Watch », qui recueille les témoignages de victimes des Russes dans la ville. « Souvenez-vous en Irak, c’est la débaasification qui a crucifié le pays, en faisant naître la rancœur chez tous les vaincus. »

Un système mafieux
Pour comprendre comment la « collaboration » s’est mise en place à Izioum, il faut reprendre le chemin des morts. Au bureau des pompes funèbres, entre les cercueils et les couronnes multicolores de fausses fleurs, Larissa, une employée, m’explique le système mafieux qui s’est progressivement mis en place. « L’entreprise de pompes funèbres d’Izioum était un business florissant sous l’occupation », dit-elle. Pas moins de 5 bureaux, dirigés d’une main de fer par Lyudmila Stetsenko et son petit-fils Igor. « Un jour de mai, le gauleiter Sokolov (ndlr c’est Larissa qui emploie ce qualificatif), accompagné de son fameux adjoint Hleb Tkachenko, sont venu nous voir et nous ont dit : ‘‘Vous voulez-vous faire de l’argent ?’’ Nous on a répondu évidemment ! ‘‘Alors commencez par enterrer gratuitement les morts à Shakespeare et on vous laissera reprendre votre business. » Les corps, qui s’entassaient sur les trottoirs, commençaient à dégager une odeur insupportable à cause de la chaleur. Avec Vitali, le croquemort, Larissa a donc récupéré les corps que les soldats russes ramassaient dans le centre-ville. « On les chargeait au niveau du pont qui enjambe la rivière Donesk et on les enterrait à Shakespeare sans cercueils. Au total, nous avons numérotés et photographiés 453 corps. Et puis, parallèlement, on a recommencé les enterrements payants. Au prix de 8000 hryvnia au lieu de 5000 avant la guerre. On était un peu débordés, alors on a demandé de l’aide aux Russes qui nous ont donné de l’essence et de la nourriture. Lyudmila et son petit-fils ont fini par quitter la ville, mais nous on a continué le business. Honnêtement, les soldats russes étaient corrects, ils nous aidaient, donnaient des bonbons aux enfants. C’étaient les soldats des républiques séparatistes de Luhansk et de Donesk qui étaient infects. »

Comment Larissa a-t-elle eu ce job lucratif en tant de guerre ? En fait, elle connaissait le « gauleiter » Sokolov, qui était garde de sécurité à la banque Privat où elle-même travaillait. « Je l’évitais à l’époque, il était poisseux, toujours à draguer les filles. » Mais après le déclenchement de l’invasion, elle l’a entendu un homme faire un discours dans la rue, et elle a reconnu le vigile de la banque. Elle n’en croyait pas ses oreilles : « Il disait vous devez reprendre le travail le premier mai, tout est calme désormais… et pendant ce temps on entendait les bombes tomber », se rappelle Larissa dans un éclat de rire. Elle connaissait également Tkachenko : « Un jour, j’ai demandé à Tkachenko pourquoi on enterrait les corps que superficiellement. Il m’a répondu que, bientôt, nous exhumerons ces corps pour faire payer aux Ukrainiens leurs crimes. » Comme elle gagnait de l’argent, Tkachenko lui a demandé si elle voulait ouvrir un compte en roubles : « Mais moi je ne voulais pas devenir Russe. C’était dur de vivre dans une ville occupée par les Russes, leur ordre, leurs drapeaux, leur radio. Mais le pire, c’étaient les pilleurs, russes ou ukrainiens : ils volaient une boutique et en ouvraient une aussitôt pour vendre ce qu’ils avaient volé. Au moins les Russes n’hésitaient pas à les punir. »

La chambre des tortures
Je le rencontre un soir sur la place centrale d’Izioum dans la file d’attente pour l’aide alimentaire. Viktor, un ex-employé du gaz, a 46 ans, et ce teint gris des hommes brisés par les épreuves et l’alcool. Sa petite datcha, où prospère un riche potager, étaient occupées par les soldats ukrainiens avant l’occupation russe. Lors de leur fuite, en mars dernier, ces soldats ukrainiens ont laissé derrière eux leurs armes et leurs uniformes. Et un des voisins de Viktor, qui enviait sa propriété et ses légumes, l’a dénoncé au nouveau « gauleiter ». Les soldats prorusses sont venus le chercher, l’ont mis en joue et l’ont conduit dans les prisons du commissariat central d’Izioum, transformé par les Russes en centre de torture.
Il m’emmène dans ce lieu terrible, aujourd’hui ouvert aux quatre vents. Sur la guérite de l’entrée, un casque rempli de pluie, des douilles, un couteau et un exemplaire en Russe de « Crime et Châtiment » de Dostoïevski. On dirait une mise en scène, dans cette ville où l’on finit par douter de tous et de tout. « Rien n’a changé » dans sa cellule du rez-de-chaussée. Viktor examine chaque objet, sa gamelle en étain, le vieux matelas, la cuillère en bois. Il a passé plus de quinze jours ici, entrecoupés de visites à l’hôpital à cause de ses crises d’épilepsie quand les coups étaient trop violents. Au sous-sol étaient détenus les condamnés à mort. « Par la fenêtre, je pouvais parler à un type de la défense territoriale, qui était dans la cellule au-dessous de la mienne. Il portait une sorte de muselière. Un jour, il m’a demandé une cigarette, je lui ai lancée mais il n’a pas pu l’attraper. Quand ils sont entrés dans sa cellule, il m’a dit : « Au revoir, je vais mourir », et j’ai entendu deux coups de feu. » Viktor est comme possédé par ce souvenir, il ne me regarde plus, il a la fièvre, comme ces personnages de Dostoïevski hantés par les crimes du passé. Il caresse un short noir aux rayures blanches qui pend à la patère de la geôle, comme pour s’assurer qu’il n’a pas d’hallucinations. Ce vêtement appartenait au jeune homme qui partageait sa cellule. « Un soir, les soldats de Lougansk sont entrés dans notre cellule, ils ont apporté un sceau d’eau, et ont demandé à Micha de se laver. Puis ils l’ont emmené et l’ont violé. Peu de temps après, on m’a libéré, je n’ai l’ai plus jamais revu. Le short noir, c’était son seul vêtement… » Le soldat de Louhansk qui violait les hommes était surnommé Bolchoï (le gros). « Il nous disait : ‘‘par le nom de la Fédération de Russie, nous vous apprendrons à vivre’’. » Il tabassait les hommes, puis les violaient. Lorsqu’il nous montre la banquette marron défoncé, protégée des regards par un drap tendu, sur laquelle les viols avaient lieu, Viktor a un haut le cœur et fait un bond en arrière.
Au bout de quelques semaines d’occupation, c’est la police de Louhansk qui a remplacé les soldats russes au rez-de-chaussée. Ils avaient promis à la population qu’ils seraient intraitables sur le crime. Un jeune homme, qui avait pris une télé dans la maison de son voisin parti pour Kiev, a été tellement battu par Bolchoï qu’il a perdu la tête. Les pilleurs, les criminels ukrainiens, ils les envoyaient directement en Russie à Voronej. Sur le sol de la prison traîne une affichette du temps de l’occupation ; on y voit la photo d’un voleur qui aurait confessé ses crimes en prison suivie de ce slogan : « Grâce à la police de Louhansk vous êtes en sécurité ». Les Russes, eux, ne s’intéressaient qu’à ceux du sous-sol, les paramilitaires ukrainien. Ceux-là, ils les torturaient jusqu’à la mort pour leur soutirer des informations.
Sacha Gluchko, 53 ans, a été un de ces morts en sursis dans le sous-sol. Parce qu’il était un des membres de l’organisation anti-terroriste créée par Poroshenko en 2014, les Tchétchènes l’ont ligoté, pieds et poings liés ensembles, et torturé à l’électricité. Sa tête cagoulée a été frappée avec un casque. Par deux fois il a été conduit inconscient à l’hôpital. Il partageait sa cellule avec un docteur, Andrej, qui n’avait plus de dents à cause des coups de poing. Et avec un grand père, Ivan Chedaï, qui s’est retrouvé à l’étage des morts à cause d’une plaisanterie : conduit à l’hôpital en hélicoptère le jour ou une bombe ukrainienne a touché une école, un de ses voisins a rigolé du fait qu’il avait dû guider le missile… Et puis le 9 septembre, un homme leur a ouvert la porte. Les Russes étaient en train de fuir la ville. La maison des tortures comptait alors 24 prisonniers.
Si Sacha Gluchko a pu remarcher, c’est grâce à Youri Evguenievitch Kouznietsov, chef du département de traumatologie de l’hôpital d’Izioum. Une gueule renfrognée à la Lino Ventura, le cœur sur la main. Enchaînant les visites, 20 heures par jour, encore aujourd’hui, il est le seul médecin à être resté dans la ville malgré les obus qui pleuvaient sur son hôpital et dont l’un lui a causé un traumatisme crânien. Il opérait sous les bombardements au sous-sol. Et même quand le « gauleiter » a changé la direction de l’hôpital, il soignait les torturés et essayait de les garder le plus longtemps dans son service. Mais il passe rapidement sur cela, pour ne pas insulter l’avenir, comme si les Russes qui campent toujours à 10 km de la ville pouvaient revenir.

Une guerre de propagande
La chef du quartier de Izos, une autre Larissa, petite femme énergique toute vêtue de rouge, connaît tout le monde. Elle navigue au pied des immeubles de 5 étages, entre les braseros des habitants qui font leur cuisine au feu de bois, faute d’électricité et de gaz. Son frère a été tué par un éclat d’obus, au début de la prise de la ville par les Russes. Elle nous présente les veuves, les torturés, les familles des collaborateurs et, dans ce chaudron de rancœurs et de peines, les récits intarissables font chavirer les auditeurs qui consignent la tragédie de l’occupation russe. Ici, les victimes côtoient donc les proches des bourreaux, comme le père de Hleb Tkachenko qui se réfugie dans sa voiture en attendant que je passe mon chemin.
C’est devant des biscotes sèches au sucre que Galina, la mère de Larissa, une adorable babouchka, nous reçoit. Fièrement, elle exhibe le nouveau journal ukrainien de la ville, « l’Horizon d’Izioum », qui a remplacé « le Z de Kharkiv », le journal de propagande russe. Page deux, un encadré montre la photo d’une femme replète d’un certain âge. C’est un avis de recherche : « Natalia lagocha est coupable d’avoir accepté de son plein gré d’être la soi-disant chef du département de contrôle des documents. Condamnée in absentia, elle est recherchée. Si elle ne se présente pas, elle risque 5 à 10 ans de prison. »
Et puis, pour nous faire rire, elle nous montre le papier journal qui enrobe ses choux, ce « Z de Kharkiv » qui déployait la propagande russe en de petits encadrés qui semblaient destinés à des enfants : « Le premier but du président Poutine est de récupérer et de sauver les terres russes du Donbass. Sa deuxième tâche est de rendre la vie de ses habitants non seulement acceptable mais utile à la Patrie », explique l’un d’eux. « Savez-vous ce que Zelensky a dit quand un missile ukrainien a tué 5 enfants ? ‘‘Notre artillerie, grâce à l’aide des Américains, est enfin précise !’’ » explique un autre encadré. Dans le cahier Science du même journal, on lit que « des chercheurs ont trouvé dans la mer du Nord un nouveau mollusque sans colonne et l’ont appelé Zelensky ». Quelques pages plus loin, on trouve un poème sur la Russie : « Gloire à toi, tu es la plus grande et la plus belle », et un photo montage d’un passeport ukrainien surmonté du Reichsadler, l’aigle du IIIe Reich.

Galina a vécu ses mois d’occupation au rythme des nouvelles de radio Z et parfois du « Z de Kharkhiv ». « Nous n’avions aucune nouvelle de l’extérieur. Enfermés chez nous, on ne savait que ce qu’ils nous disaient », soupire la vieille dame. Et puis, un beau jour, un voisin a acheté un générateur et l’immeuble de Galina a pu voir la télé ukrainienne. « En une heure, on a appris trois mois de nouvelles, les massacres de Butcha, mais aussi l’engagement de la communauté internationale a nos côtés ! » Un peu comme dans le film « Good Bye Lenine » quand, après un long coma, une femme découvre le monde post-soviétique que lui cachait son fils.
Nadia, qui dirige le pâté de maisons qui longe le cimetière Shakespeare, a aussi été bercée par la propagande de radio Z. Elle ne croit pas que les Russes ont commis des exactions. Ils lui ont donné de la nourriture et du dentifrice, et les médecins russes, dit-elle, soignaient les malades de la rue. Son mari est dans la construction, son beau-fils est croquemort et ils ont continué à travailler sous l’occupation. A l’heure du déjeuner, sa table se couvre de viande, de cèpes et d’une tarte aux fruits. Elle pense qu’il y a des « gens mauvais » dans chaque camp, et renvoie les politiciens russes et ukrainiens dos à dos : « Nous, les civils, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des objets pour que l’on passe de mains en mains, d’un camp à l’autre. Un jour nous devront bien vivre ensemble, côte à côte et plus face à face ! »
Au moment de quitter Izioum, je vois une dame aux traits tirés sortir de sa maison. Je m’arrête : Natalia Vassilivna, 67 ans, vient de Borodychne, une ville à 40 km d’Izioum, et elle fond en larmes dans mes bras quand je commence à l’interroger. A la veille de l’invasion russe, elle s’était réfugiée dans les grottes des moines du monastère de Sviatohirsk, mais les moines étaient de l’Église de Russie et lui récitaient plus régulièrement que leurs prières la propagande russe. Alors elle est retournée dans sa ville se cacher dans un abri d’où les soldats de Poutine ont fini par la déloger après avoir pilonné la ville. Avec 32 personnes, elle a dû marcher pendant deux jours, buvant l’eau des ruisseaux, et mangeant l’herbe des talus, zigzaguant entre les cratères des bombes. A Izioum, tout le groupe est monté dans des bus direction de la Russie, tous sauf elle. Car une doctoresse, Svetlana Danielovna, au péril de sa vie, l’a cachée dans une petite clinique. Aujourd’hui Natalia a acheté un vélo et une petite charrette et entend bien retourner chez elle : « Maudit Poutine, dites bien ce qu’il nous a fait, tout le monde doit savoir ».



L’article A Izioum, après 164 jours sous la botte russe : « Maudit Poutine, dites bien ce qu’il nous a fait, tout le monde doit savoir » est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>L’article Reviews est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>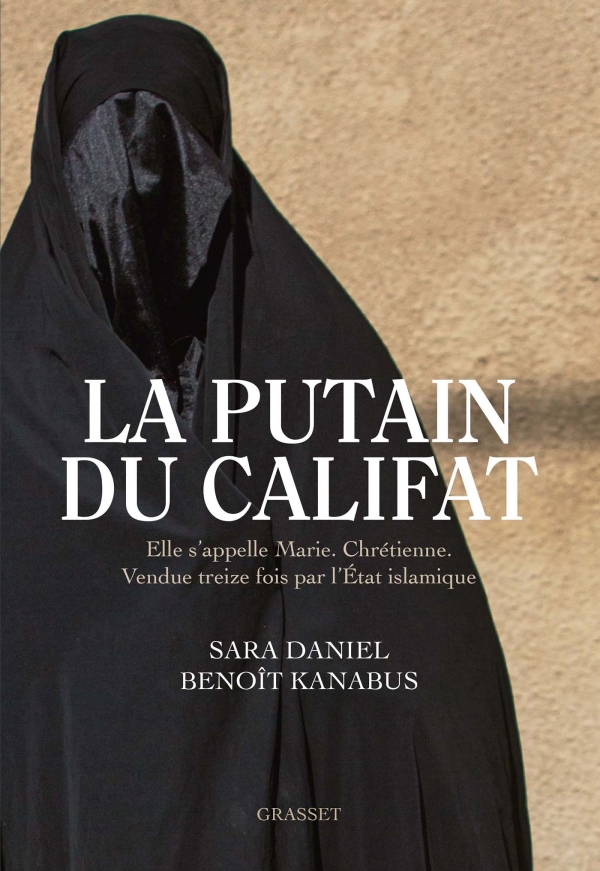
“This book’s literary quality, the range of registers that it deploys in a nearly kaleidoscopic panorama, achieves the feat of plumbing the darkest depths with a soberness that resists all voyeurism.”
La Libre Belgique
“A clarion call to the edge of the brothel, the edge of the abyss. The first Christians’ tales can be heard resounding there, whispering Aramean consolations and howling genocidal horrors. A story all, especially those who would deny Islamist fascism, should read.”
Marianne
“From the end of the world, the ‘whore of the Caliphate’ has been pleading over and over for five years for this message to be passed on. ‘I hope the United Nations will support my cause and bring it before the International Court of Justice. It’s what I need to reclaim my dignity,’ she declares.”
ELLE
“The fruit of many years’ labor, this volume is just as valuable as it is horrific. It describes the rise of Islamic fundamentalism and the fate of Western Christians. Their voices, freed at last from obscurity, feed this literary text written by four hands.”
L’Express
“This poignant text offers a deep reflection on religion, faith, and God, questioning Islam and Christianity alike.”
Femme Actuelle
“In this moving story about the conditions of Daech slaves, all man’s sins are incarnated in this female body.”
Le Canard Enchaîné
Author Biographies:
Sara DANIEL, writer and special correspondent at L’Obs, is the author of Voyage aux pays d’Al-Qaïda (Seuil) and Guerres intimes, De l’Afghanistan à la Syrie (Flammarion).
Benoît KANABUS, former researcher at the Fonds national belge de la Recherche scientifique (FNRS), and guest professor at various universities, witnessed the Battle of Mosul alongside the Christians.
L’article Reviews est apparu en premier sur Sara Daniel.
]]>